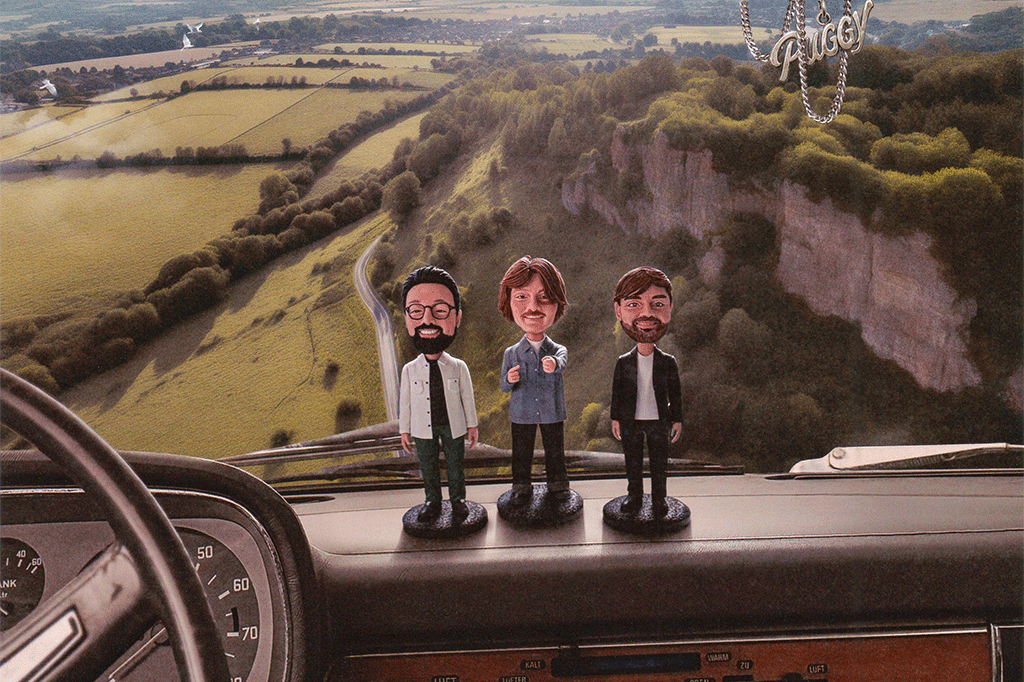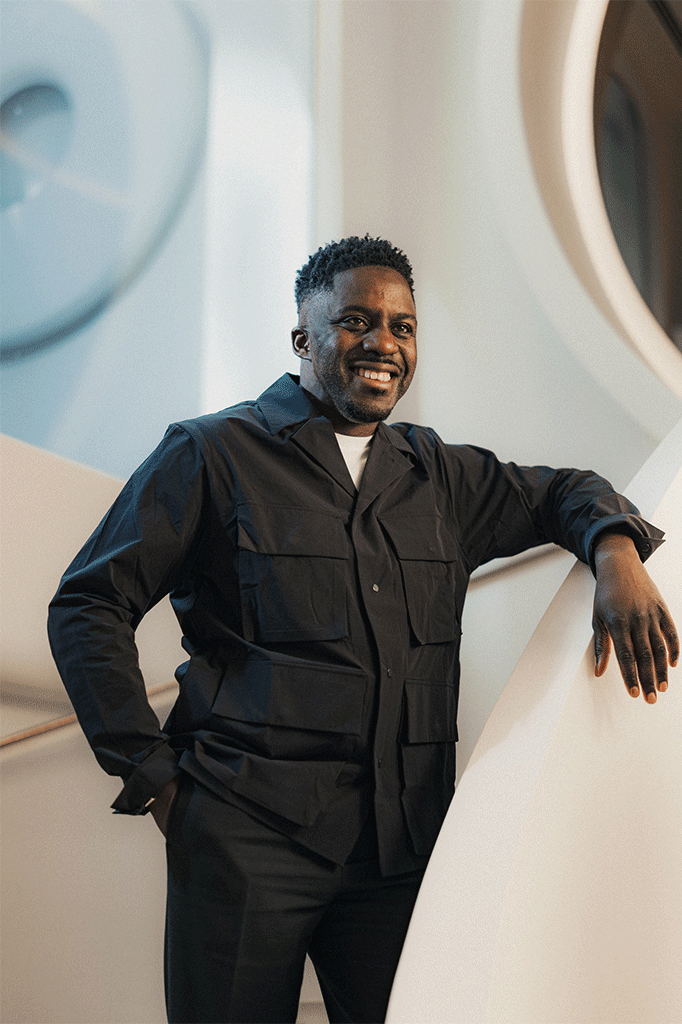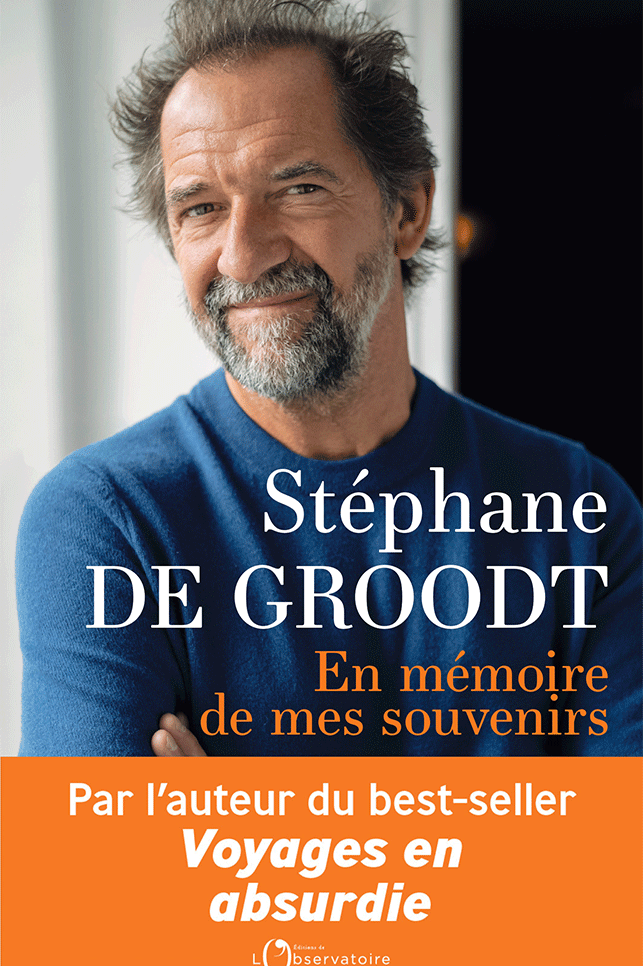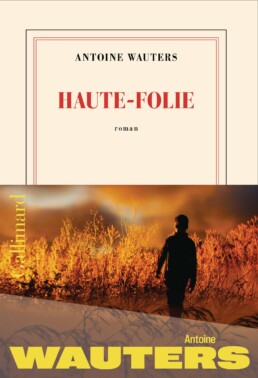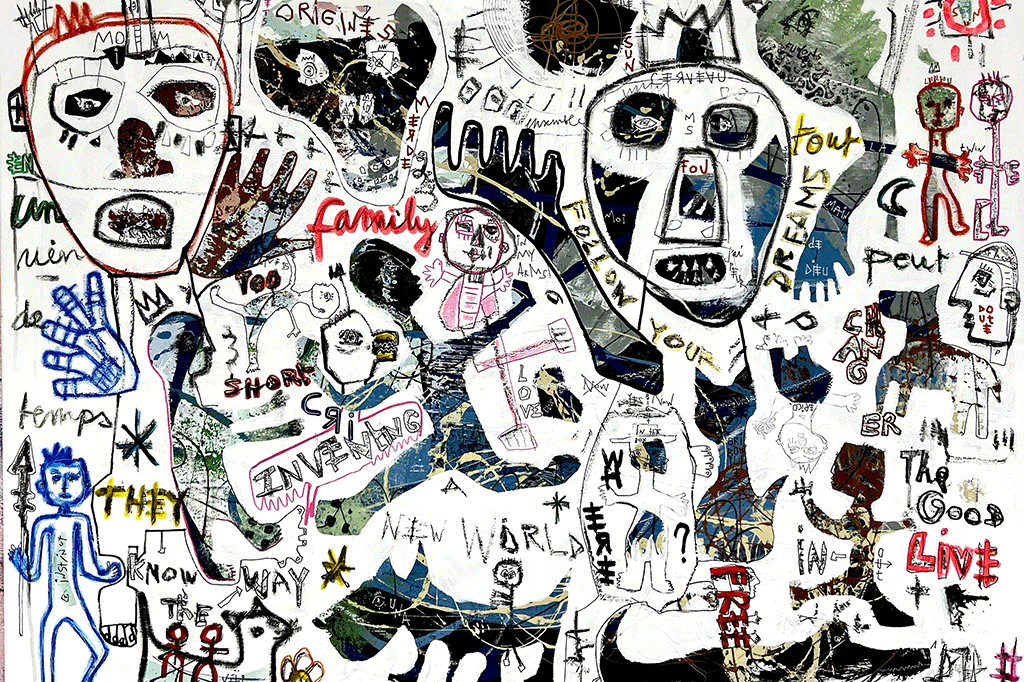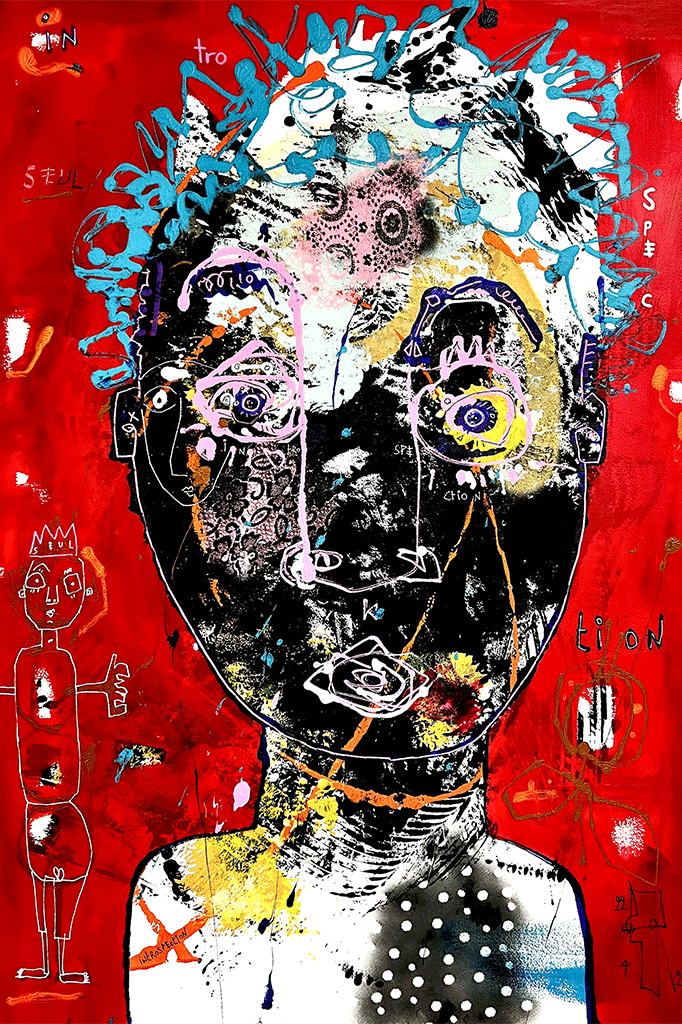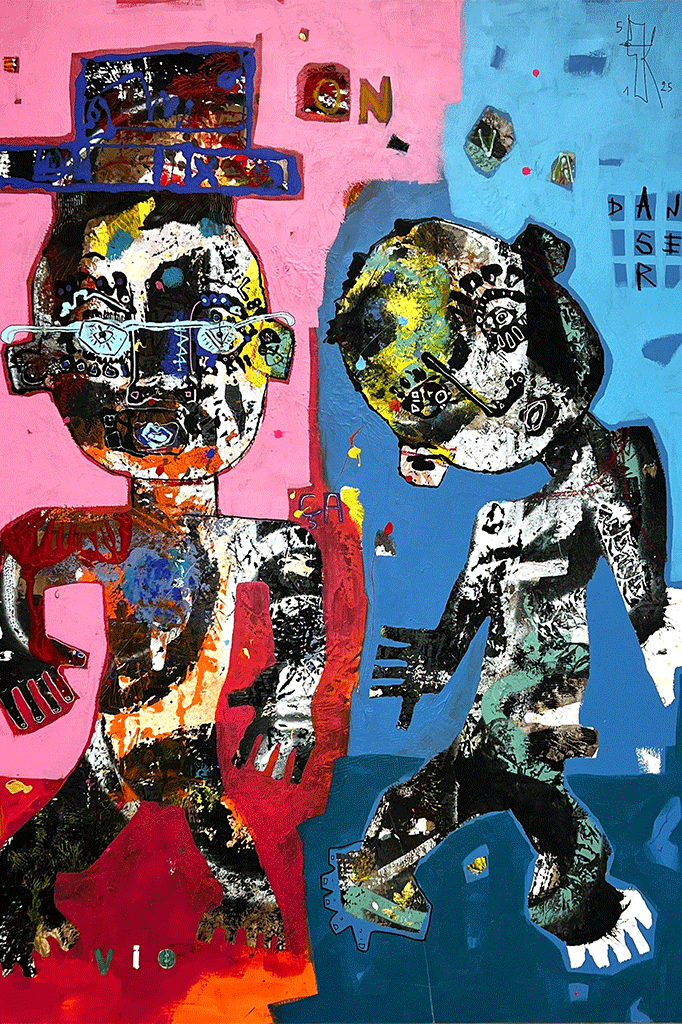Florence Mendez « Le rire est une forme ultime d’espoir »
Florence Mendez
« Le rire est une forme ultime d’espoir »
Mots : Barbara Wesoly
Photos : Jon Verhoeft
Coiffeur et make-up artist : Luc Depierreux
Stylisme : Jules Depierreux
Elle couche les mots pour réveiller les consciences. Monte sur scène comme d’autres le font au front. Par conviction. Florence Mendez revient cet hiver avec un nouveau spectacle de stand-up Bella Ciao et un second roman Bang Bang. Deux échos pour une même voix, lucide et profondément sensible, tranchante et irrésistiblement drôle. Rencontre avec une artiste désarmante de talent.
Votre nouveau spectacle Bella Ciao est aussi engagé qu’incisif, évoquant notamment la montée de l’extrême droite, le masculinisme, la xénophobie, et la nécessité d’entrer en lutte pour notre humanité. Quel a été le déclencheur de son écriture ? Son moteur a été le relâchement du cordon sanitaire et le fait que l’extrême droite envahisse les espaces de parole de manière exponentielle en Belgique et en France, ces dernières années. J’ai ressenti une vraie urgence face à cette montée en puissance et sa gravité. Et son nom l’incarne en lui-même, puisqu’il s’agit du titre d’un chant italien devenu symbole de lutte contre le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. Après Délicate qui abordait mon parcours, diagnostiquée du trouble du spectre autistique sans déficience à 30 ans et HPI, je trouvais très égocentrique de continuer à parler de moi. Je voulais au contraire développer ma vision de notre époque et de ce que je rêverais qu’elle soit. Défendre une forme de résistance qui est aujourd’hui d’utilité publique.
Sur scène, dans vos chroniques radio, comme en interview, vous vous exprimez sans filtres et sans tabou. N’hésitant pas à être cash, incisive, frontale, quitte à choquer si c’est pour défendre vos convictions. Cela demande-t-il par moments du courage à l’hypersensible que vous êtes ? C’est un besoin viscéral, même si cela signifie en effet m’exposer à des critiques et sanctions. Je ne pourrais agir autrement. Je me sers de l’outrance pour faire réagir, caricaturant les traits absurdes de notre société pour rappeler qu’ils sont dangereux et non pas banals. Être une humoriste engagée et une femme qui fait un métier public, c’est en effet malheureusement aussi se confronter, sur les réseaux notamment, à des insultes et des menaces de mort, de viol. Il faut être solide. Mais cela ne prouve que d’autant plus la nécessité absolue de s’insurger et de prendre la parole.
Vous n’avez de cesse de dénoncer le sexisme, le racisme, et les inégalités. L’injustice est-elle ce qui vous ébranle le plus ? Oui, et ce depuis toute petite. Je suis convaincue que l’on a besoin d’une empathie radicale, non seulement de manière individuelle mais aussi collective et étatique. Il faut sortir d’un fonctionnement axé sur la méritocratie, l’égoïsme et le rejet des autres. L’humour est une façon de combattre, de ne pas laisser s’éteindre son intégrité. Mais il faut savoir taper au bon endroit, au bon moment, trouver la forme et le message juste. Ce n’est pas un exercice facile et je me plante encore souvent. Je sais aussi que je blesse immanquablement des gens et je l’accepte. Nous n’avons pas tous les mêmes sensibilités, le même vécu. Mais je refuse par contre de faire de l’humiliation, du harcèlement ou de la violence un fonds de commerce. Être subversif n’est pas se moquer d’une forme de faiblesse ou de différence, ce n’est au contraire qu’une preuve de lâcheté.
Le rire fait-il parfois office d’armure contre l’impuissance ? Complètement. Face à l’innommable, face au pire, à l’enfer absolu, il est par moments tout ce qui reste. Une forme ultime d’espoir. Le rire devient alors la preuve que l’on est encore en vie. Que le désespoir n’a pas gagné. C’est salutaire.
La Florence Mendez des débuts, en 2016, est-elle toujours la même que celle d’aujourd’hui ? Dès ma première chronique, cet humour engagé était déjà là. Il était hors de question à mes yeux de ne pas la transformer vecteur de mes valeurs. Mais lorsqu’on se lance dans le stand up, il y a une espèce d’ivresse du rire. Et tous les leviers sont bons pour l’atteindre. Depuis j’ai grandi, mûri, je ne suis plus dans cette recherche constante de validation. La vraie réussite est aujourd’hui d’entraîner une réflexion.
Votre premier ouvrage, Accident de personne, déroulait le fil de thèmes qui vous sont essentiels : la santé mentale, la difficulté de trouver sa place, et de nourrir des pensées noires. Son écriture était-elle libératoire ? Totalement. Je peux déverser bien plus de mes doutes et de mes défauts dans mes personnages. Malgré l’aspect fictionnel, c’est un exercice très intime, solitaire aussi. En spectacle, on s’attend à une réaction immédiate, visible, sonore. L’écriture est au contraire très intérieure. Elle me permet de m’exprimer, pleinement, sans m’interroger sur l’effet que produiront mes mots.
Le livre vient d’être republié avec un bandeau rouge signé d’Amélie Nothomb le qualifiant de Définition même du talent. Ce type d’éloge contribue-t-il à éloigner le syndrome de l’imposteur que vous disiez avoir longtemps ressenti ? Oui c’est un immense honneur. Tout comme la reconnaissance de la communauté qui me suit, dont le soutien est très précieux. Je pense qu’être restée intègre et avoir toujours refusé de trahir mes opinions m’a permis de créer des liens très forts avec mon public. Je ne recherche pas une approbation universelle, mais avoir la reconnaissance d’individus que j’estime, d’auteurs que j’admire, me touche infiniment. Cela m’a porté pour ce second roman, m’amenant à oser développer mon intrigue beaucoup plus loin, car je m’en savais désormais capable.
Vous vous apprêtez en effet à publier Bang Bang, son successeur, qui paraîtra au début de l’année 2026. Il a pour fil rouge le harcèlement scolaire et résonne de façon intime avec votre expérience. Pourquoi maintenant ? C’est venu de lui-même, sans doute porté par les témoignages toujours plus fréquents d’enfants dans les médias. L’impossibilité d’admettre qu’à neuf, dix ans, on puisse s’ôter la vie par désespoir. Dans mon métier je suis confrontée au manque d’empathie des adultes et aux conséquences dramatiques que son absence a sur le monde et c’était important de l’évoquer. Comme pour mon premier livre, j’ai choisi de jouer le jeu d’une forme d’intrigue provocatrice, puisque mon héroïne, Tess, décide de combattre le harcèlement qu’elle subit dans son lycée en organisant une tuerie de masse. Mais l’histoire reste le décor, pas le sujet ni le fond, seulement un moyen d’accéder à l’essentiel.
Que vous souhaitez-vous pour le futur ? Je rêve d’adapter un jour Accident de personne au cinéma, de passer derrière la caméra pour donner une dimension supplémentaire au roman. Mais avant tout, je me souhaite d’être plus sereine et moins anxieuse par rapport à l’évolution de notre société. Que mon fils aille bien également. Je lui dois de me battre pour un monde qui va mieux. Et pour faire perdurer l’espoir.
Instagram : mendez_florence
RORI : « J’ai envie de faire ma place en France »
RORI
« J’ai envie de faire ma place en France »
RORI
« J’ai envie de faire ma place en France »Mots : JASON VANHERREWEGGE
Photos : GREGORY DERKENNE
Camille Gemoets, plus connue sous le nom de scène de RORI, poursuit son ascension avec son deuxième EP « Miroir ». Après avoir conquis la Belgique avec « Ma saison en enfer », sublimé par des titres comme « Docteur » ou « Ma place », la Liégeoise vise désormais la conquête de la France grâce à une patte toujours aussi incisive et une aversion certaine pour les chansons d’amour.
Depuis quelques années, vous semblez vivre un véritable conte de fées avec un enchaînement de hits et l’accumulation de scènes. Parvenez-vous à vous lever le matin et à vous dire que vous êtes la plus belle devant le miroir ? Jamais ! (rires) Je ne me lève pas en me disant que j’ai réussi. Justement, c’est le contraire. Je me dis toujours qu’il faut que j’écrive un truc chouette et que je fasse de la bonne musique.
Vous n’épargnez pas la société dans ce deuxième EP. Effectivement ! Je fais une satire de notre vie qui est très narcissique. Je constate que nous sommes tous devenus complètement fous à vouloir devenir les meilleurs, les plus beaux, à n’importe quel prix. Cela ne concerne pas une génération en particulier mais c’est vraiment un problème de société.
En parlant de conte de fées, le grand méchant continue d’être les réseaux sociaux. En 2023, vous nous affirmiez : « Si je ne faisais pas de la musique, je serais absente des réseaux ». Cela n’a pas beaucoup changé. C’est très piégeux car ça te force à te comparer aux autres et à souvent te dévaluer. Tout ce que l’on produit doit devenir quelque chose avec du profit. Il y a une véritable compétition qui s’est installée dans tous les métiers. C’est assez malsain. Personnellement, je n’ai pas envie de suivre cette ligne de conduite. J’ai passé ma vie à essayer de sortir d’un schéma, ce n’est pas pour qu’on m’en remette un nouveau dans la figure parce que, soi-disant, ça plaît aux gens. Tant pis si j’ai moins d’abonnés.
Peut-on réussir sans les réseaux sociaux à notre époque ? J’ai envie de croire que oui. Il y a des groupes qui font des tournées et qui remplissent des salles sans avoir énormément de followers sur Instagram. On entend évidemment plus parler de ceux qui ont plus de visibilité parce qu’on les voit mais la réalité est plus nuancée.
Une chanson comme « Loser » participe à la révolte de ceux qui veulent détruire les étiquettes. On a tendance à oublier le chemin parcouru. Cette chanson me permet de me souvenir que j’étais à la base dans quelque chose qui ne me convenait pas. J’ai réussi à m’en extraire alors que les gens autour de moi m’en dissuadaient et ne m’encourageaient absolument pas à aller vers autre chose. Ils ne savaient pas eux-mêmes qu’il y avait un autre chemin. J’ai tourné ça en revanche pour que ce soit plus universel mais je ne vais pas aller retrouver des gens pour me venger (rires). On peut parfois se sentir perdu et trouver quelque chose qui nous convient et qui nous parle.
Avez-vous toujours la même rage contre l’adolescence, cette époque difficile de votre vie ? J’en ai moins mais j’ai toujours des petites séquelles comme le manque de confiance ou d’estime de soi. Ça va prendre du temps à cicatriser. Ce sont les premières années de nos vies et c’est tellement présent que tu grandis un peu de travers. Mais je travaille dessus.
Comment se passe votre rapport aux autres aujourd’hui ? J’ai du mal à faire confiance aux gens. Je parle très peu de ce que je ressens vraiment et c’est là que la musique me permet de mettre des mots sur ce que je pense.
Dans « Plus jamais », justement, vous donnez votre avis pour le moins original sur l’amour. J’ai vraiment sorti ce titre car on m’a déjà demandé plusieurs fois pourquoi je ne faisais pas de chansons d’amour. J’en ai donc fait une dans laquelle je tue la personne (rires). Ce n’est pas quelque chose qui m’inspire énormément. Ça découle une nouvelle fois du fait que je n’accorde pas énormément ma confiance. Je ne me laisse pas vite emporter par les paroles des gens.
Est-ce une obligation de faire des chansons d’amour ? C’est tellement universel que ça parle à beaucoup de monde. Mais il y a une part de timidité me concernant. Il faut des chansons pour tout le monde et j’en fais pour des gens qui ne sont pas nécessairement aussi honnêtes avec le sentiment d’aimer quelqu’un. Peut-être que dans deux ans je ne ferai que des chansons d’amour et on ne m’ennuiera plus avec ça. Non, je rigole !
Première partie de Lana Del Rey, réédition de « Butterfly » avec Superbus, tournage de « Vérité » à Hong Kong ou encore concert au Vietnam. Vous semblez prendre unedimension internationale depuis quelques mois. Ce qui est important pour moi, c’est surtout de faire de la musique qui me parle et dont je suis fière. Vivre des choses à l’international, ça me fait évidemment très plaisir mais ça ne dépasse pas ce sentiment. Par ailleurs, j’ai déjà envie de faire ma place en France. C’est très compliqué de viser la scène internationale car il y a telle- ment d’artistes.
Instagram : roriwithi
OZARK HENRY : « Il faut savoir vivre avec nos imperfections »
OZARK HENRY
« Il faut savoir vivre avec nos imperfections »
OZARK HENRY
« Il faut savoir vivre avec nos imperfections »
Mots : JASON VANHERREWEGGE
Photos : LUKAS DESMET
Huit ans après son dernier opus, le Courtraisien de 55 ans Piet Goddaer, alias Ozark Henry, revient avec un dixième album intitulé « August Parker ». Une invitation pour tous, enjolivée par un son immersif, à investir davantage dans son empathie dans un monde qui tend de plus en plus vers l’intelligence artificielle.
Près de trente ans après vos débuts, appréhendez-vous encore la sortie d’un disque ? Je ne cherche pas à convaincre mais plutôt à partager avec le public. Personne n’a le devoir d’écouter. J’ai hâte d’avoir les réactions car c’est pour moi ma meilleure œuvre.
En quoi se distingue-t-elle des autres ? C’est une histoire d’expérience, de maturité et en même temps j’ai encore le même sentiment que pour mon tout premier album. Je sais que j’ai 55 ans mais je me sens très jeune quand je fais de la musique. Je suis très proche de l’esprit que j’avais quand j’avais 18 ans et j’ai en parallèle la maturité qui accompagne mon âge. C’est une richesse.
Si vous gardez le nom de scène Ozark Henry, un nouveau personnage fait son apparition : August Parker. Pourquoi avoir créé un nouvel alter ego ? Je rassure tout le monde : je suis toujours le même ! (rires). Le fait d’avoir un nom d’artiste était surtout à la base quelque chose de pratique car mon nom Piet Goddaer est difficile à prononcer dans les autres langues. Quand j’ai participé au projet avec l’Orchestre National de Belgique en 2015 (un enregistrement stupéfiant dans lequel il interprète ses plus belles compositions de concert avec l’ONB, NDA), je suis tombé dans un monde que je ne connaissais pas. Celui du son immersif. J’ai alors voulu explorer davantage les rouages techniques et émotionnels de cette technologie. J’ai vite compris que c’était le format le plus naturel pour moi. À ce moment-là, comme c’était un autre monde et que j’étais un pionnier dans le secteur, j’ai décidé de me donner le nom d’August Parker à chaque fois que je travaillerai désormais dans la 3D. Je me suis toutefois rendu compte que ce personnage était finalement très proche d’Ozark Henry.
Votre album transmet des ondes particulièrement positives. Dans « Dancer in the night », vous évoquez le fait de « faire la paix avec nos cicatrices » en les acceptant et en ne formant qu’un avec comme dans le Kintsugi, une méthode de réparation japonaise. Avez- vous réussi à le faire de votre côté ? Oui. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, c’est souvent pour cette raison que nous n’arrivons pas à vivre ensemble. Les choses ne sont pas parfaites dans la vie et nous devons savoir l’accepter. Il faut savoir vivre avec nos imperfections pour parvenir à faire preuve d’empathie envers autrui. Je ne pensais pas que nous puissions revivre une période où le fascisme prend petit à petit le pas sur la démocratie. Certaines personnes tentent de justifier l’injustifiable, comme à Gaza, en affirmant que c’est complexe mais ça ne l’est pas !
Vous vous investissez depuis longtemps dans des causes humanitaires comme en participant aux campagnes de Médecins sans frontières. Êtes- vous aussi optimiste que vous l’êtes pour vous avec le monde ? Je vis près de Ypres qui a lourdement souffert de la Première Guerre mondiale. Pourtant, aujourd’hui, c’est dur de trouver des « cicatrices » sur place. Il faut donc faire preuve de résilience et se dire qu’on peut survivre à des situations horribles.
Sans digression, revenons à votre son qui semble avoir autant d’importance que les paroles. Est-ce finalement le cas avec l’utilisation du studio Ozark Henry dans ce dixième album ? Il ne faut pas se méprendre : les paroles sont quand même la clé de voûte des chansons. Le son, lui, c’est l’image et le contexte qui les enjolive. Je considère le tout comme un film. Quand tu racontes une histoire, les dialogues sont importants mais l’ensemble doit être efficace et le son permet de créer ce monde.
En 2017, vous expliquiez de manière imagée que vous êtes devenu un sculpteur alors que vous étiez auparavant un peintre. Vous avez donc versé dans une nouvelle forme d’expression ? Effectivement. J’ai effectué cette comparaison pour expliquer le fait que faire de la 3D est tout simplement une autre manière de travailler.
Des éloges de David Bowie aux partages d’émotions professionnelles avec Toots Thielemans ou encore Moby, votre carrière a été saluée par beaucoup. Qu’est-ce qui vous motive encore aujourd’hui à faire de la musique ? Je suis persuadé que partager de la musique a du sens et augmente la qualité de vie. C’est une langue qui permet de transmettre ce que tu ne sais pas exprimer autrement. Je suis ambassadeur de « Together Stronger », un mouvement qui soutient les victimes de terrorisme, et j’ai été amené à gravir le Mont Dore en France avec des dizaines d’entre eux. Sur place, j’ai chanté pour eux et j’ai senti que ça avait de l’importance. Ils m’ont donné de la force. C’est l’une des raisons pour lesquelles je fais encore de la musique.
Instagram : ozarkhenry
MOJI X SBOY
MOJI X SBOY
« Notre envie est de braquer l’industrie musicale »
Mots : JASON VANHERREWEGGE
Photos : KELVIN KONADU
Pépites du rap belge, les deux amis liégeois Moji et Sboy, âgés respectivement de 26 et 25 ans, jouent la carte de l’authenticité et de l’audace sur leur premier album « Quitte ou double », histoire de prouver que, dans ce jeu qu’ils maîtrisent déjà, ils n’ont jamais misé à perte.
Qu’est-ce qui fait votre singularité sur la scène musicale ? Il y a un essor énorme de rappeurs aujourd’hui qui proposent des styles complètement différents. Ce n’est pas facile de faire son trou mais on essaye de se démarquer grâce à notre musicalité et notre esthétique visuelle. On se creuse la tête sur tout : des visuels à la cover en passant par le stylisme. On voit des artistes qui ont du budget pour le faire mais ils préfèrent rester dans une certaine zone de confort.
À la différence d’un All-In au poker, vous avez tout de même assuré vos arrières avec un Bachelier en Gestion hôtelière pour l’un et un Master en Ingénieur Civil en Informatique pour l’autre. Ce n’était pas une option d’abandonner les études. C’est avant tout un souhait de nos familles qui nous ont inculqué ces valeurs. C’est aussi une sécurité : comme on sait ce qui nous attend si jamais demain on arrête la musique, on prend le présent comme une chance. Après, nous sommes passionnés par ce que l’on fait et donc on est obligé de le faire à fond.
L’aspect financier occupe une place importante dans cet album. Vous chantez par exemple que « L’argent et moi c’est passionnel » dans votre premier titre « Longtemps ». La légende du rap Booba affirme à ce propos : « L’argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur, lui, ne remplit pas l’assiette ». Vous le rejoignez sur cette idée ? Dans le projet, il y a une phrase qui dit : « L’argent ne fait pas tout mais je préfère être triste dans une Maybach ». C’est vraiment ça. On parle un peu de nos styles de vie qui ont changé car le monde de luxure fait fantasmer. Mais on le fait toujours en rejoignant la DA (direction artistique, NDA) de « Quitte ou double » qui est de tout miser sur nous-même. On veut être au top dans le milieu pour espérer faire le grand braquage un jour. Notre envie est de braquer l’industrie musicale.
Si l’argent permet d’être plus libre, vous faites part aussi de ses limites à la fin de l’album sur «Rolex»et «3am sur BX » en évoquant la solitude que cela peut entraîner. On a commencé naïvement en étant motivé par la pure passion. On a eu de la chance, ça a directement pris et un peu après on a vu que ça générait de l’argent. Dans les faits, c’est un moyen de manifester. Nous ne sommes pas millionnaires mais on aspire à cette aisance en venant d’un milieu précaire. Ici, on fait des choses qu’on n’aurait jamais imaginé pouvoir se permettre comme manger dans de grands restaurants ou dormir dans des hôtels de luxe. Quand tu le vis, tu te dis cependant que ce n’est peut-être pas si bien que ça au final. Il y a cette remise en question perpétuelle, cette espèce de combat intérieur, où tu te demandes si c’est vraiment ça que tu veux. On peut vite devenir ingrat si on ne reste pas dans nos baskets.
Pour vous protéger, vous expliquez vouloir garder votre famille proche. Par contre, l’amour est « secondaire » si on en croit vos paroles sur « Mode avion ». Tout le monde connaît cette période où on est tellement obnubilé par nos objectifs que tout le reste est secondaire. Aujourd’hui, on a tellement envie que ça fonctionne qu’on en oublie parfois le reste. C’est une activité qui nous prend toute notre âme.
Si vous avez débuté sur des sonorités lo-fi et des thèmes romantiques, vous êtes passés depuis quelques années à des productions trap modernes. Pourquoi ce changement ? Après « Temps d’aime » (leur tout premier projet sorti en 2021, NDA), on était déjà sur des productions différentes. On a commencé par le rap mais Moji x Sboy ce n’est jamais un même style. Ce que l’on n’aime pas, ce sont les artistes qui font quinze chansons sur la même thématique avec le même axe. Tu peux vite tourner en rond et c’est là que tu perds l’authenticité et la fierté. On voulait garder cette surprise derrière chaque morceau. Nous n’avons pas envie de nous mettre dans une case et on se voit un peu comme un groupe multifacettes.
Vous êtes tous les deux originaires de Liège. Pourtant, vos références semblent être très liées aux États- Unis. Les États-Unis ce n’est pas parfait du tout. Mais ils ont le sens du specta- cle, du divertissement et ça se ressent dans la musique, les séries, etc. Ils sont beaucoup plus créatifs et débridés là-bas et c’est quelque chose qui nous inspire depuis très longtemps. Quand on a commencé le rap, on était en plein dans l’explosion de la scène SoundCloud avec XXXTentacion, Trippie Redd, Juice WRLD…C’étaient des mecs qui nous ressemblaient. Tu as d’office une identi- fication plus facile et plus rapide. Depuis très longtemps, finalement, on a les yeux rivés sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier de le dire, ça vient de là-bas aussi.
Instagram : moji.sboy
PUGGY : « C’est un privilège de pouvoir poursuivre le voyage »
PUGGY
« C’est un privilège de pouvoir poursuivre le voyage »
Mots : JASON VANHERREWEGGE
Photos : Victor Pattyn,Luca Mastroinni
Vingt ans après sa fondation, le groupe Puggy, emmené par Matthew Irons, Romain Descampe et Egil « Ziggy » Franzen, se réinvente une nouvelle fois avec toujours autant de fraîcheur et de positivité à travers un sixième album inédit, « Are We There Yet? » (« Est-ce que nous y sommes déjà ? »), conçu au sein de leur propre studio de production.
Pour votre premier album depuis 2016, qu’est-ce que vous vouliez faire transparaître en premier ? Comme nous avons sorti un EP il y a un an (Radio Kitchen, NDA), marquant véritablement notre retour et l’introduction de notre nouvel univers, nous avons été un peu plus décontractés pour cet album. On voulait juste avoir quelque chose qui déchire avec de bonnes chansons. Le titre, c’est la continuation de « Never Give Up ». C’est cette idée que nous avons beaucoup de chance de faire de la musique depuis toutes ces années. Nous avons certes acquis notre propre studio, produit de la musique, coécrit ou encore fait de la musique de film mais nous n’y sommes toujours pas. C’est un peu un voyage infini où tu te dis que tu as toujours des trucs à apprendre. Maintenant on a tous des enfants et les gosses passent leur vie à demander quand on est-ce qu’on arrive. Finalement, on est toujours excité par l’avenir et on continue notre chemin.
Votre voyage est avant tout introspectif avec des odes à l’épanouissement personnel ou encore à la résilience ? Complètement ! C’est un privilège de pouvoir poursuivre le voyage. Ce n’est pas comme dans le sport où parfois tu arrives à ton top et tu dois ensuite trouver un truc à faire et t’adapter. On a de la chance de pouvoir encore jouer de la musique, en créer, en produire et on prend toujours autant de plaisir à le faire.
Pensez-vous déjà avoir atteint le top ? C’est difficile à dire. À chaque album, nous sommes persuadés que c’est le meilleur. Chaque artiste pense de la sorte sauf ceux qui sont suicidaires. Mais ici nous sommes arrivés à un stade où on a tout enregistré chez nous. On a mixé certains titres et on a pu, de la compo à la finalisation, le gérer de nos propres mains. C’est le cas aussi pour la commercialisation. C’est encore un cap. Par ailleurs, on est encore en train d’apprendre plein de choses. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore à notre top.
Que cela change-t-il concrètement dans votre processus de création ? Y a-t-il des choses que vous n’auriez pas pu faire sans cette totale indépendance ?La grosse différence, c’est que c’est ton argent. Tu es donc plus responsable et tu vas dans chaque détail. L’avantage, aussi, c’est que tu ne comptes pas les heures. Il y a plein de choses qui font que c’est peut-être plus personnel. Au final, il y a sans doute deux ou trois morceaux que nous n’aurions peut-être pas faits.
Vous n’avez pas hésité à utiliser l’intelligence artificielle pour réaliser le clip de « Never Give Up ». Avez-vous eu recours à cette technologie pour vous suppléer dans une autre tâche ? Nous ne l’avons pas utilisée pour nous aider à écrire des chansons. Il faut que tu ressentes ce que tu écris et ce que tu dis. Quand tu laisses quelqu’un ou quelque chose le faire à ta place, ça ne t’appartient plus et ça te touche moins. Par ailleurs, on se sert quand même de RhymeZone, intégré dans ChatGPT, qui permet de trouver d’autres rimes quand tu galères sur tes textes.
Rock, électro, pop moderne, grandes mélodies R&B… L’album oscille entre différents états. C’est la raison pour laquelle on fait aussi beaucoup de productions pour d’autres artistes. C’est quelque chose qui nous inspire énormément. Après, il faut quand même que ça reste du Puggy. Il y a un son et on essaye de le respecter mais on veut aussi que ce ne soit pas quelque chose de figé. C’est important pour nous que chaque album sonne différemment. Il y a donc plein d’influences différentes qui alimentent le fameux son Puggy. On a aussi de la chance d’avoir un chanteur qui a une voix ultra-reconnaissable. C’est ce qui centre un peu notre son.
Sur le titre « Mirror », dans lequel l’artiste Maëlle apporte une touche française à l’opus, vous évoquez le fait de se perdre et de ne plus se reconnaître. Depuis votre fondation en 2005, avez-vous eu le sentiment de parfois vous égarer en route ? Pour créer, tu es obligé de te perdre en permanence. Après, est-ce que nous avons eu des crises identitaires ? Pour pouvoir revenir il y a quelques années, il y en a eu une petite. Nous nous sommes demandé en 2023 qui était Puggy. La question s’est posée aussi de savoir comment définir un groupe de musique aujourd’hui. Il faut dire que ça n’existe quasiment plus.
Après vingt ans d’existence, votre créativité semble avoir été nourrie par divers projets comme le cinéma, les jeux vidéo ou encore l’écriture orchestrale. Oui et non. Ça nourrit forcément notre inspiration mais ça nous prend aussi en parallèle énormément de temps. Si nous n’avions pas tout ça, nous ferions encore plus de chansons.
KODY : « Pour être irrévérencieux, il faut être curieux »
KODY
« Pour être irrévérencieux, il faut être curieux »
Mots : JASON VANHERREWEGGE
Photos : MORTEMPO
Boulimique de travail, Kody Seti Kimbulu, dit Kody Kim ou simplement Kody, continue de multiplier les casquettes en partant en tournée avec son nouveau spectacle « Évolué ». L’incarnateur du Grand Cactus y évoque ses origines, la violence dans le monde ou encore l’évolution de la technologie.
Scène, série, télévision… Vous ne vous arrêtez jamais. Pendant quelques années, j’ai véhiculé une image de personne dilettante mais je n’ai finalement jamais glandé. Au contraire, j’ai multiplié les projets. Au-delà de ce que vous avez cité, je suis ou serai à l’affiche de plusieurs films dont « Muganga » qui revient sur l’histoire du docteur Mukwege (prix Nobel de la paix 2018, NDA) et qui s’attarde sur des femmes violées avec une extrême violence dans l’est du Congo. C’est une fierté car c’est l’occasion de parler de ce conflit qui fait des millions de morts depuis des années. On peut être utile de la sorte.
Si vous êtes en pleine quête d’évolution, vous affirmez ne pas encore vous connaître totalement. À l’approche de la cinquantaine, qu’est-ce qui vous échappe ? Je ne me rends même pas compte de mon âge (47 ans, NDA) ! Mon physique ne coïncide pas encore avec cet âge-là. Je donne l’impression à certains d’avoir 35 ans et moi-même j’en ai encore 25 dans ma tête. J’aimerais avoir cette maturité. J’ai quand même une certaine sagesse en moi mais je reste cet être un peu irrévérencieux et malicieux. En même temps, j’aime bien ce trait de ma personnalité et il faut que je conserve ça. Pour être de la sorte, il faut être curieux, ouvert et candide. Si je perds cette facette, je vais perdre mon intérêt. Quand on devient parent, il faut osciller entre candeur et responsabilité. J’essaie de la perdre par moments et de la retrouver facilement.
En 2022, vous nous expliquiez que le fait de vous enfermer dans le rôle d’humoriste du Grand Cactus était votre plus grosse hantise. Vous affirmiez alors que vous signeriez pour une ultime saison. C’est vrai ! (rires) L’arrivée de nouveaux cama- rades comme Damien Gillard a donné un nouveau souffle à l’émission. Ces gens-là donnent envie de jouer avec eux. Je m’amusais déjà avec James Deano et Martin Charlier mais ça apporte encore plus de dynamisme.
Vous avez débuté en septembre une nouvelle série qui sera diffusée en 2026 sur La Une. Dites-nous-en plus. C’est l’adaptation d’une série québécoise qui s’appelle « Les Beaux Malaises ». Ce programme décrit la réalité et le quotidien de pas mal de mes confrères humoristes qui ont un peu de notoriété. Je me retrouve dans beaucoup de choses qui sont écrites. Maintenant, il faut l’adapter car ce n’est plus la même époque (la série originale date de 2014, NDA). On est aussi en Belgique, je suis d’origine congolaise, noir, et donc ça change quand même pas mal de choses. Ça permet d’évoquer des sujets que les gens ne connaissent pas toujours. Le fil conducteur de cette série, c’est le fait que l’humoriste est en panne d’inspiration pour son nouveau spectacle. On le voit dans sa vie quotidienne faire des choses banales dans lesquelles il peut trouver de l’inspiration. Comme je joue mon propre rôle, ça va être aussi une chouette expérience d’être le personnage principal. C’est une série humoristique avec également des aspects plus profonds.
Transmettre des messages reste primordial à vos yeux dans votre métier ? Je ne cherche pas à faire mon « Tchao Pantin ». Mais, dans la vie, je suis comme ça. Tout le monde l’est d’ailleurs. Personne n’est à 100 % un clown sinon ça devient vite fatigant. Dans le cas contraire, ça me fait peur (rires).
Depuis quelque temps, vous êtes très bankable et votre nom est de plus en plus cité en France. Vos rêves se trouvent-ils désormais de l’autre côté de la frontière ? Mon terrain de jeu, c’est la francophonie. Évidemment, la France en fait partie et c’est la plus grosse vitrine. Je ne cherche pas spécialement à y percer mais j’ai envie de m’étendre sur la francophonie.
Cela implique de nombreux voyages. Comment gère-t-on ce paramètre au niveau familial ? Bien vu ! Et voilà, je retourne dans mes travers (rires). C’est l’intérêt d’aller travailler en France, un pays qui n’est pas très loin de la Belgique.
Lors de notre dernière interview, vous veniez de signer pour l’agence de talents américaine CAA. Quel bilan en tirez-vous trois ans plus tard ? Grâce à cette agence, j’ai prêté ma voix pour des dessins animés. J’ai aussi eu l’opportunité de prester dans une espèce de comédie musicale. Il y a eu par ailleurs une grosse crise de l’industrie du cinéma avec la grève des scénaristes et il y a tout un système qui est en train de changer. C’était donc un peu plus compliqué ces derniers temps, d’autant plus que la distance n’aide pas pour aller faire des castings. Mais, finalement, c’est pareil en France où j’ai aussi un agent. Je n’ai pas fait mille films. Il faut avant tout être patient. Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon. Et je travaille mon endurance.
Le 23 octobre au Cirque Royal de Bruxelles et du 14 au 26 novembre en Wallonie.
Instagram : kody_kim
STÉPHANE DE GROODT
STÉPHANE DE GROODT
« Affirmer ce que l’on est plutôt que de s’enfermer dans ce que les autres aimeraient que l’on soit »
Mots : Barbara Wesoly
Photo : Pascal Ito
Six ans après « L’ivre de mots », Stéphane
de Groodt revient à l’écriture par le biais de l’autobiographie. « En mémoire de mes souvenirs » raconte le pilote de course épris de vitesse comme l’homme en quête de lumière, le comédien virtuose des mots autant que l’individu qui, de ses fragilités d’enfance a fait le socle de son talent. Un récit de vie(s) d’une singulière authenticité.
Vous expliquez avoir, par ce livre, revisité les ruelles de votre existence. Pourquoi ce choix d’y retourner pour vous y balader ? Le point de départ est venu de mon éditrice, qui m’accompagne depuis les débuts de mon aventure littéraire. Elle souhaitait me ramener à l’écriture et m’a un jour demandé pourquoi je ne raconterais pas mon histoire. Sur le moment, ça m’a semblé absurde. Je n’imaginais pas qui cela pourrait intéresser. Mais quelques semaines plus tard, m’est venue une première phrase. D’autres s’y sont petit à petit ajoutées, à mesure que dans mon esprit se formait une réflexion plus globale sur ce qui compose un parcours de vie. J’avais envie de la partager et ainsi de convoquer ceux qui le liront dans un récit qui pourrait également être, d’une certaine façon, le leur.
En mémoire de mes souvenirs aborde des sujets aussi intimes que la perte de votre maman, votre TDAH, votre rapport à l’amour et à votre rôle de père. Cette forme de mise à nu était-elle un exercice évident ou difficile ? C’est fascinant comme démarche, cette revisite de ce qui a pu nous animer. Une fois que les souvenirs revenaient en surface, il était assez simple de m’y replonger. Le plus dur était de trouver un fil rouge, la raison d’être de les coucher sur papier. Je suis quelqu’un de très pudique et parler de sentiments et d’événements aussi personnels m’a confronté à la question de ce qu’il faut garder pour soi ou non. Mais je sais que chaque moment de ce parcours m’a construit. C’est ce qui m’a décidé à oser en aborder toutes les étapes.
Vous écrivez : « J’aurai cherché toute ma vie ce regard et cette main posée en guise de réconfort, pour me signifier que je suis attendu et que j’existe ». Cet ouvrage a-t-il été celui d’une réconciliation avec vous-même ? Je pense en effet que dire permet d’atteindre une forme d’apaisement. On planque souvent des sentiments sous le tapis, nous obligeant ensuite à avancer sur un terrain mouvant, accidenté. Il faut parfois accepter de regarder ce qui se cache sous la surface, d’enlever les aspérités encombrantes pour pouvoir marcher plus facilement. C’est une image, mais qui reflète profondément ce que j’ai ressenti. Notamment en évoquant mon ex-femme et mes absences, en m’exprimant sur cette part de mon passé comme je ne l’avais peut-être jamais fait. Je me rends compte que je n’aurais pu écrire ce livre il y a dix ans.
En vous offrant aussi le droit à éprouver une certaine fierté pour ce parcours multiple et atypique ? La fierté est une notion dans laquelle je ne me retrouve pas. Peut-être parce que plus jeune, j’ai eu le sentiment d’en avoir eu beaucoup et de l’avoir mal placée. J’en ressens aujourd’hui à l’égard de mes proches, mes enfants en particulier, mais étant un éternel insatisfait, m’accorder cette reconnaissance à titre personnel est difficile. Comme je le dis dans cet ouvrage, je suis dans un mouvement perpétuel, où le présent n’existe pas. Accepter d’être fier voudrait dire m’y inscrire.
Tout au long de ce récit de vie, vous affirmez en effet « nourrir la passion des promesses et des éternels recommencements ». Quels en seront les prochaines étapes ? « En mémoire de mes souvenirs » marque la fin de plusieurs chapitres, voire de plusieurs livres, dans la bibliothèque de mon parcours. C’est un premier bilan, avec ses espoirs, ses réalisations et ses actes manqués. Celui aussi de ce que je ne ferai plus. Je ne rentrerai plus par la fenêtre pour exister. Il y a désormais de la place pour d’autres rêves et ce livre a remis de l’encre dans mes ambitions et mes envies. J’aimerais reprendre la plume pour une deuxième pièce de théâtre, un long-métrage, un roman. Je trouve un plaisir infini dans l’écriture.
En guise de fin, retournons aux premiers mots de votre ouvrage. Ceux où vous vous interrogez sur sa raison d’être et de vous raconter. Vous y affirmez éviter de vous concentrer sur ces questions, pour vous focaliser sur les réponses. Les avez-vous trouvées ? Je me pose encore énormément de questions et heureuse- ment d’ailleurs. Mais j’ai malgré tout répondu à celle qui me taraudait depuis le début. Aujourd’hui, je sais que je l’ai écrit avec l’envie que ceux qui le liront y trouvent la force d’aller au bout de leur rêve, de tout tenter pour se réaliser et pour vivre. Je ne pensais pas arriver à coucher des mots au-delà de la troisième page. Le livre illustre en lui-même l’importance d’oser, y compris dans l’abrupte, quand il n’y a pas de voie tracée. Je suis heureux de le voir exister.
En mémoire de mes souvenirs, Stéphane De Groodt, aux Éditions de l’Observatoire.
Myriam Leroy - « La honte et le déshonneur sont très volatils »
Myriam Leroy
« La honte et le déshonneur sont très volatils »
Mots : : Jason Vanherrewegge
Photo : Romain Garcin
Dans sa nouvelle pièce de théâtre « Cellule de crise », comédie sur fond de thriller politique née sur les braises d’une hypothétique cancel culture, la dramaturge Myriam Leroy nous offre un huis clos aussi drôle que grinçant dans lequel un homme vivant dans la terreur de tout perdre et d’être annihilé suite à un scandale potentiel de harcèlement sexuel au sein de son ministère a une heure pour écrire un communiqué de presse.
Vous avez tenu à le préciser d’entrée de jeu : nous sommes loin du théâtre à message pour votre nouvelle pièce. Je déteste le premier degré. Il n’est pas interdit que ça me joue parfois des tours d’ailleurs. Ici, il n’y a pas un personnage qui est particulièrement plus moral que les autres. Il y en a un qui se présente comme tel mais on se rend compte au fur et à mesure que chacun est humain et a peut-être quelque chose à défendre qui ne serait pas forcément de l’ordre de la vertu. C’est clairement un spectacle politique sur les dominations, notamment sexistes, mais il n’y a pas un immonde prédateur et de formidables angelots qui sont là pour défendre une idée de justice pure et universelle.
Les spectateurs, même s’ils seront mis parfois dans l’inconfort, vont pouvoir rire. Les personnages qui ne sont pas très conscients de ce qu’ils sont, c’est toujours drôle. Même si les sujets abordés sont plutôt durs, grinçants ou éruptifs. Les personnages ont des morceaux de bravoure à défendre et c’est là aussi que se niche la comédie.
L’ironie est-elle la meilleure manière de dénoncer et de conscientiser sur ce genre de problématique ? À part dans les essais, qui ne touchent généralement qu’un public déjà convaincu, le premier degré n’est pas toujours une bonne solution. Ça peut avoir tendance à braquer les gens, les pousser dans l’idée qu’ils sont jugés pour des comportements qui ne seraient pas conformes à la norme. Je préfère y aller par des chemins détournés.
Vous y voyez une forme de vulgarisation ? Dans les faits, il y a une forme de vulgarisation dans le spectacle. Il y a trois personnages et chacun incarne un archétype contemporain très marqué. Il y a l’homme de pouvoir, la féministe énervée et la femme anti-féministe. Ce sont des archétypes qui sont partout dans l’espace public, notamment sur les réseaux sociaux. En parallèle, il y a pas mal de personnes qui vont passer complètement à côté de ce que je raconte parce que c’est avant tout un théâtre à texte avec des relations humaines. Finalement, je ne pense pas que ce soit de la vulgarisation mais davantage de la mise en situation de concepts dont on parle beaucoup.
Cinq ans après le début de l’écriture de votre pièce, la réalité ne semble pas avoir tant changé que cela. On a surtout fait beaucoup de retours en arrière idéologiques et sociétaux. Le conservatisme est vraiment revenu en force avec des paroles virulemment anti-féministes et anti-progressistes. Cela a conduit d’ailleurs à modifier une partie du spectacle. On pouvait envisager à l’époque de voir quelqu’un accusé d’inconduite sexiste et sexuelle vraiment vivre dans la terreur de tout perdre mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. La réélection de Donald Trump aux États-Unis, alors qu’il venait d’être condamné, en est la preuve éclatante. La honte et le déshonneur sont très volatils.
Cela fera bientôt dix ans que vous avez écrit votre première pièce « Cherche l’amour ». Que vous apporte de plus le théâtre par rapport à vos débuts dans le journalisme ? La coopération avec des comédiens, une metteuse en scène, le fait d’être tous tendus vers un même but, une même envie… Ça a été une découverte assez fondamentale par rapport au journalisme qui est un exercice solitaire. Ça m’a aussi convaincue que la fiction pouvait être un vecteur de restitution du réel parfois plus fin que la simple restitution par les médias traditionnels. Tout simplement parce qu’on a plus le temps. Dans des temps d’une telle cacophonie comme aujourd’hui, la fiction permet de raconter clairement les choses.
La transmission est quelque chose d’important pour vous qui avez débattu à plusieurs reprises avec des adolescents dans les écoles. Pensez-vous que les mentalités ont évolué au fur et à mesure des années depuis la sortie de votre roman « Les Yeux rouges » (2019) et de votre film documentaire « #SalePute » (2021) ? Il y a toute une partie de la jeunesse qui tend vers plus de progressisme, qui a des idéaux d’égalité très marqués, et en même temps une partie qui est très réfractaire à cela. Beaucoup de jeunes filles sont très militantes, lisent énormément de bouquins et elles cohabitent souvent avec des jeunes garçons qui sont biberonnés à des contenus masculinistes. Avec les années, je remarque que les positions sont de plus en plus polarisées. D’autre part, il faut quand même se réjouir qu’il y ait toute une partie de la population qui soit extrêmement éclairée. Cela n’existait pas il y a dix ans.
Cellule de crise au Théâtre de la Toison d’Or du 16 octobre au 29 novembre 2025
Antoine Wauters « J’ai cessé d’opposer l’écriture à la vie »
Antoine Wauters
« J’ai cessé d’opposer l’écriture à la vie »
MOTS : BARBARA WESOLY
PHOTOS : JON VERHOEFT
COIFFEUR ET MAKE-UP ARTIST : LUC DEPIERREUX
Il capte la poésie des paysages intérieurs, fait résonner le tumulte des silences et puise l’humanité dans l’indicible. Écrivain, philosophe, voix bouleversante, Antoine Wauters dévoile, avec son roman « Haute-Folie », un récit universel au fil des générations, entre déracinement, mémoire et lien.
« Haute-Folie » raconte le destin de Josef et au-delà, l’impossibilité d’échapper à son histoire familiale, inscrite en soi comme une seconde peau. Pensez-vous que nous sommes tous forgés par cet héritage ? Oui, je suis convaincu que nous en sommes tous les porteurs. Les garants des générations qui nous ont précédées, dont nous charrions les bagages, parfois très beaux, ou au contraire empreints de souffrance et de non-dits. Dans ce livre, j’ai plutôt sondé cette veine-là. Racontant l’existence de Josef, orphelin qui, jusqu’à l’âge adulte, grandit à l’ombre de son histoire, ignorant qui sont ses vrais parents ni quel fut leur destin. Et la douleur, issue non pas du vécu, mais du silence qui l’accompagne. Nombreux sont ceux qui se rendent un jour compte qu’on leur a caché les premiers moments de leur propre vie et de la difficulté à se défaire de ses fantômes. L’histoire de l’humanité n’est au fond que cela. Une tentative de s’extraire de la transmission ou d’en conserver le meilleur. Il faut plusieurs générations pour pardonner les vestiges de son héritage. Mais écrire est une façon d’essayer de penser ces plaies-là. Josef, malgré le filtre de la fiction, est à la fois un personnage très proche de moi mais aussi de membres de ma famille.
Le roman puise donc ses origines dans une histoire personnelle ? Certaines parts en tout cas. Parfois la vie prend du retard sur l’écriture. Par des sentiments, des situations, dont on pressent qu’il faut attendre de les avoir connus pour qu’ils puissent surgir. Ce livre parle ainsi de la filiation et la distance avec ceux que l’on aime. Les premières images m’en sont venues alors que j’allais être papa pour la première fois. J’ignorais à l’époque que je ne vivrais pas tous les jours avec mes enfants. Ce roman m’a accompagné quinze ans avant que je parvienne à l’écrire. Non pas à essayer de coucher les mots sur une feuille, mais à être un père qui découvre leur absence dans le quotidien, un manque violent et déstabilisant. Tout a alors pris son sens. Il y a énormément d’intensité dans ces expériences qui nous façonnent et qui sont à la fois sombres et lumineuses. Dans les chemins que l’on emprunte, comme dans ceux de nos paysages intérieurs.
Haute-Folie, c’est aussi le nom de cette ferme au cœur du drame de plusieurs générations, est-elle en définitive le personnage principal du livre ? J’aime l’idée qu’un endroit puisse contenir des destins et que son nom même puisse influencer l’histoire de ses habitants. Il existe véritablement une ferme de la Haute-Folie, dans la province de Liège où j’habite. Je m’y suis rendu à plusieurs reprises. Rien ne la discerne visuellement d’une autre, mais en la découvrant pour la première fois sur une carte topographique j’ai été fasciné par ce terme. L’on flirte tous en permanence avec des états de sagesse et d’autres borderline. La folie, c’est le pays des souffrances qui n’ont plus nulle part où aller. Cette phrase du roman le raconte finalement à elle seule.
De « Nos mères » à « Mahmoud ou la montée des eaux » et aujourd’hui à « Haute-Folie », l’absence s’impose dans vos ouvrages. L’absence à soi ou au monde, des autres comme de paix. Quelle place prend-elle dans votre existence ? Je crois que la personne que je suis est apparue quand j’avais huit ans. Dans un moment de révélation, dont les enfants en ont le secret. J’en ai parlé dans mon roman autobiographique « Le plus court chemin ». Alors que j’allais voir mes grands-parents à vélo, j’ai eu l’envie terriblement forte de me jeter droit dans le mur qui bordait leur jardin. Je ne sais pas d’où est venu ce désir soudain et étrange d’autodestruction. Et ensuite cette pensée que non, je ne le ferais pas, car je tenais à moi. Déjà à huit ans, j’avais l’impression de traverser l’existence comme un fantôme et encore aujourd’hui j’ai le sentiment de ne pas être là pour moi mais pour capter des courants, des ambiances, des sons. Certains connaissent une position intermédiaire, entre la vie et la mort, le visible et l’invisible, la joie et la non-joie. Je fais partie de cet équipage-là. Et j’écris pour tenter de communiquer ces états qui nous traversent tous.
Dans cet ouvrage, vous affirmiez d’ailleurs « quelqu’un qui écrit revient toujours de loin, c’est un revenant ». Les mots sont-ils pour vous une forme d’oubli ou de retour à soi ? Un peu des deux. La possibilité de descendre dans nos profondeurs et de se mettre à distance. Avant, écrire un livre me donnait l’impression de gravir l’Everest et quand j’arriverais au sommet, je me disais que je ne recommencerais pas. Que c’était trop coûteux en énergie, en temps, en renoncement. Aujourd’hui je peux passer six à huit mois de l’année sans noter une ligne, mais ensuite soudain cela va très vite et je considère désormais l’écriture comme une voie d’accès extraordinaire, notamment à mes grands-parents disparus. Comme une forme d’absence à moi-même qui me permet une vraie présence aux autres, à ce qui m’entoure, à ce qui vient. Grâce à cela, j’ai cessé d’opposer l’écriture à la vie.
L’on ne quitte pas indemne vos personnages d’une profondeur et d’une sensibilité rares. Quelle marque laissent-ils en vous ? Je suis caché en chacun de mes personnages, même si c’est parfois à des degrés infimes. Il ne s’agit pas véritablement d’autobiographie. Tout y est moi, à moi, mais d’une façon que je choisis de doser. Je remets beaucoup en question la notion d’identité. J’estime que nous avons le droit de nous transformer, d’embrasser ces métamorphoses que nous ressentons en une journée comme en toute une vie. Mais, Josef, comme le personnage de Mahmoud ou les jeunes auteurs de pamphlets du « Musée des contradictions » vivront toujours en moi. Chacun a marqué un cycle d’existence, une plongée dont on revient ensuite comme d’un long voyage, en ayant vieilli. Nous sommes des millefeuilles de tous nos âges.
Vous faut-il un temps de silence après avoir apposé le mot « fin » ? Un temps loin des récits ? On peut se remettre directement à vivre. A écrire non. J’aimerais un jour réussir à noter le mot fin à un livre et puis rien. Ne pas avoir besoin de publier, ne pas rechercher d’approbation extérieure. Avoir trouvé suffisamment de sagesse en moi pour me dire que la beauté d’un texte se suffit à elle-même. Et en même temps je prends énormément de plaisir à rencontrer et partager avec les gens autour de mes ouvrages. En parallèle à « Haute Folie », j’ai achevé un second livre, dont la sortie est prévue dans un an et demi et pour l’instant, je m’offre de lire, de m’imprégner pleinement du monde. Je suis heureux car j’ai atteint une période de mon existence où tout ce qui avait été opposé, écrire, vivre, s’immerger en profondeur ou au contraire faire la fête, s’est finalement réconcilié. J’ai acquis une forme de légèreté, quitté cette croyance qu’il faut être sérieux dans tout ce que l’on fait. Tout est un jeu en réalité. Écrire est un jeu, un immense plaisir, un espace où on se révèle à soi. Je souhaite à chacun de trouver un lieu qui lui permette d’être à ce point lui-même.
Haute-Folie d’Antoine Wauters, Gallimard.
DUGA
DUGA
« C’est par la déformation que l’humain se reflète dans toute sa vérité »
Mots : Barbara Wesoly
Photos : DR
Sous le patronyme de Duga, Christian Dugardeyn questionne la nature humaine d’une voix singulière et vivante. Celle d’un conteur visuel, dont chaque trait d’une beauté brute interpelle avec sensibilité et explore l’identité personnelle autant que l’émotion collective.
Vous êtes médecin et artiste depuis près de quarante ans. Deux métiers parallèles, deux vocations, dont vous évoquez pourtant la connexion et la résonance en vous. Où se rencontrent-ils ? C’est l’humain qui les relie, dans sa complexité et sa vie intérieure. Il est le ciment de mon travail, qu’il soit médical ou artistique. Je serais incapable de renoncer à l’un de ces deux univers. Ils retentissent l’un sur l’autre, interagissent et se répondent. Ils ont d’ailleurs toujours évolué côte à côte. Adolescent, je rêvais d’entrer aux Beaux-Arts, mais mes professeurs, au vu de mes résultats, me poussaient vers la médecine. J’ai finalement réalisé les deux cursus en même temps. Je me suis ensuite spécialisé en imagerie médicale, une discipline qui malgré un principe profondément rationnel a aussi un aspect très visuel, presque artistique. Je ne pouvais pas choisir à l’époque et je ne le peux pas plus aujourd’hui.
Par la radiologie comme par le pinceau et la sculpture, vous sondez finalement l’humain, aussi bien littéralement que symboliquement. Y cherchez-vous des réponses ? C’est une quête constante de compréhension, entre interrogation et expérimentation, bien qu’elle soit par moments inconsciente. Et une recherche qui commence en soi-même. Les personnages que je crée sont à la fois des autoportraits et un reflet de la nature humaine, que chacun perçoit selon un éclairage personnel. Plus qu’un sens ou un message, c’est une émotion que je souhaite transmettre. Je ne sais jamais vers quoi une création va me conduire. Je pars en exploration, sans modèle, sans chemin tracé. Parfois, rien ne vient et puis par moments, l’émotion surgit, un trait part, suivi par des dizaines d’autres. C’est un état presque second, où l’on est seul face à soi-même, porté par l’instinct, avec une intensité brute et viscérale.
Vous dites que c’est en « déformant les choses que l’on se rapproche de la vérité », celle du ressenti, de l’image ? On vit dans un monde devenu très réaliste, terriblement terre à terre. Où on nous proclame des vérités absolues et où on ne réfléchit plus. J’ai le sentiment qu’en s’éloignant de cette forme de limpidité, en quittant ce qui est compréhensible au premier coup d’œil, on va alors pouvoir véritablement susciter un chamboulement qui ne laissera pas indemne. C’est ce qui m’a amené dès le départ vers l’art figuratif libre, sans vraiment le décider. J’ai la certitude que c’est par la déformation que l’humain se reflète avec le plus de vérité et de réalisme. Laissant apparaître ce qui est sinon aussi fondamental qu’invisible.
Pour vous, qui êtes tant dans le rapport à l’être, aux êtres, quelle importance prend le regard des spectateurs sur votre travail artistique ? Il m’apporte une analyse, une forme de compréhension incroyable. Des mots sur des contrastes et des sentiments qui étaient jusque-là restés aux limites de mon champ de vision, qui s’étaient imposés sans que je le réalise. Ainsi que sur la portée de ces influences qui me guident et imprègnent viscéralement ce que je crée. La passion des arts africains et amérindiens, des arts modernes et premiers aussi. L’élan pour des artistes comme Basquiat, Alechinsky, Picasso ou Dubuffet, dont la vision et les œuvres accompagnent cette réflexion sur la nature humaine.
Vous mélangez et variez les outils, expliquant avoir voulu désapprendre les principes techniques appris aux Beaux-Arts. Votre créativité se nourrit elle de cette déconstruction ? Totalement. Une fois épuisée une voie, il est essentiel d’en chercher une autre, pour rester dans l’émotion. C’est ce qui m’a amené pendant deux, trois ans à partir vers l’art abstrait, avant de revenir au figuratif. Tout autour de moi dans mon atelier, on retrouve des crayons ou de l’acrylique, mais aussi des plaques d’aluminium, du plexiglas, des portes de voitures, du bois, des peintures en aérosol. Je refuse d’être prisonnier d’un courant ou d’impératifs fixés par d’autres. Et j’accepte les demandes seulement si elles font sens pour moi, aussi variées soient-elles. Des séries de petites tailles pour des galeries à Paris ou la représentation d’une famille sur un capot de véhicule. Une exposition à la Affordable Art Fair de Stockholm en octobre ou des poupées Kokeshi que je reproduis pour l’instant en bronze, influencé par un voyage au Japon que j’ai fait récemment. En quarante ans, ma créativité a évolué, mes envies aussi. Ce n’est pas un chemin linéaire. Je n’aurai pas assez d’une vie pour développer toutes mes idées. Mais c’est cette recherche constante qui me passionne et j’espère bien qu’elle ne prendra jamais fin.
I : duga_art